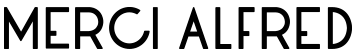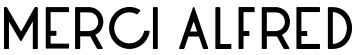La plume et la cuisse
Les écrivains du Tour de France
29-06-2017
Plus qu’un pic, un cap, une péninsule, pour eux, le Tour de France est un conte, un mythe, une épopée. Voici trois textes des plus grands écrivains du Tour... qui pourraient bien faire basculer votre mois de juillet et vous donner envie de regarder le Tour.

En 1956, les étapes du Tour ne faisaient pas 200 bornes, mais 350. Les vélos ne pesaient pas 8 kg, mais 15. Et les routes de montagne n’étaient pas des billards aux revêtements parfaitement roulants, mais plutôt des chemins muletiers à peine goudronnés.
“La course sortait des Alpes par les gorges du Cians. Depuis une dizaine de kilomètres, on vivait dans une cicatrice de la terre. Pas une habitation ; pas un être humain ; pas un mètre de chemin sur lequel la cluse en refermât sa muraille rouge d’où l’eau ruisselait, arrachant aux parois des éclats de rochers qui s’en allaient teinter en contrebas les flots rosés du torrent. Cette plongée hallucinante avait achevé de disséminer les coureurs, idoles gluantes tombées de la montagne, une par une, comme les perles d’un collier rompu. Les voitures suiveuses elles-mêmes s'abandonnaient à un destin individuel. Chacun ne roulait plus que pour soi, soucieux de rapatrier sa carcasse dans la vallée… Soudain, dans le pan coupé d’un virage, on aperçut une silhouette fichée, avec un bicyclette soudée aux pieds. Personne devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche : seule, cette épave au regard vitreux, saisie dans un bloc de gel et d’absence, geignant. Il tremblait et des ondes rapides secouaient les muscles de ses cuisses tachées de sang. Il n’avait même plus ce réflexe de remonter en selle qu’ont les coureurs dans le coma athlétique, quand on leur présente un vélo. Le devoir ingrat consistait à lui dire : “Repars pendant que tu es un peu chaud encore… Roule doucement, il y en a d’autres derrière…” Et lui, il répondait : “J’ai froid.”
Il y avait là, dans cette voiture où nous étions, des bidons de thé, des aliments. Mais le règlement interdit aux suiveurs et aux parents de ravitailler les concurrents. Ceux-ci ne doivent tenir leur provende que du hasard des rencontres et, en quelques points privilégiés du parcours, de l’initiative des organisateurs. Du moins était-il permis de lui offrir un peu de chaleur, avec les moyens du bord. On l’amena contre le moteur de la voiture qu’on fit tourner plus fort. On souleva le capot et il resta là un moment, à demi allongé sur le radiateur, les yeux braqués sur ce coude précis de la descente où, l’instant d’avant, il dévalait à soixante-dix à l’heure, ses mains agiles caressant les poignées de freins avec aisance et certitude. Maintenant, ses mains, il les promenait dans sa chevelure dégoulinante où le sparadrap d’une blessure de la veille lui faisait une tonsure. Puis il tâtait en vain les poches de son maillot, vides comme son bidon et comme son regard vide. Cet homme n’avait plus rien au monde, que la peau et les os perçant à travers son cuissard déchiré. “Du courage ! … Monaco n’est pas loin (100km!). Tout à l’heure tu verras la mer, tu seras chez toi…”

Mais c’est qui, ces gens qui poireautent des heures sur les routes du Tour pour entr’apercevoir des mecs en cuissard qui les dépassent en ½ seconde à peine ? Ces supporters qui sont dans tous les virages, ils sont là depuis les débuts du tour, et ils sont toujours aussi à fond... comme le montre cet extrait où Dino Buzzati décrit la dérive de Gino Bartali.
"Bartali a été semé. Dans la côte de Pratola, à 50 kilomètres de Salerne, Fausto Coppi pédale de toutes ses forces. Il est en tête d’un groupe d’une dizaine d’autres coureurs, mais parmi eux ne se trouve aucun membre de son équipe, il passe en solitaire : “Et Bartali ?” demandent les gens. Bartali n’est pas là. Bartali est-il dans le second groupe ?
Le soleil, des collines verdoyantes, un môme, des pins, des vignes, trois autres moines sous un peuplier. Une toute petite fille, qui bat des mains. De soudains nuages de poussière là où la route est en réparation. Des gamins de tout âge. Un homme estropié, dans sa petite voiture. Des nuées qui viennent de l’est. Et sous la petite casquette blanche son visage anguleux, cuit par le soleil et la fatigue. Il regarde vers l’arrière. Personne ne vient l’aider ? Non, personne… Il a déjà pris quatre-cent mètres d’avance ; il en a cinq cents, six cents, à présent.
Devant nous, qui le précédons, une étendue de mains qui s’agitent, faisant un geste interrogatif typique des gens du sud, doigts joints et tendus vers le haut. C’est un appel péremptoire, presque indigné. Ils sont là, à attendre depuis une heure, ils n’en peuvent plus, ils veulent savoir. Qui est en tête ? Qui gagne ? Que sommes-nous venus faire ici - ont-ils l’air de dire - si ce n’est leur apporter des nouvelles ? Qui est en tête ? Coppi. “Bravo !” hurlent les garçons en faisant des sauts de joie en l’air et en échangeant des coups de poing pour exprimer leur joie. En ce moment, ils nous embrasseraient, ils seraient disposés à faire n’mporte quoi pourvu que cela nous fasse plaisir. D’autres visages, cependant, s’assombrissent avec une promptitude quasiment ridicule. “Et Bartali ?” Bartali est derrière. “Bartali a été lâché ?” nous hurlent-ils en implorant un démenti de notre part. Il n’y a rien à démentir, c’est bel et bien cela. Mais nous n’avons pas le temps de discuter. Nous fonçons à travers les campagnes ; à une vitesse vertigineuse des visages sans cesse renouvelés défilent sur notre droite et notre gauche par milliers, interminables galerie humaine dans un état d’extrême excitation. Ces gens ont tout oublié : ce qu’ils sont, le travail qui les attend, les maladies, le luxe, les traites à payer, les maux de tête, l’amour, tout excepté ce fait mémorable : Fausto Coppi est en tête, Bartali a du retard et continue à perdre du terrain."

Pour les fans de vélo, les champions cyclistes sont de véritables rock stars. Certains plus que d’autres, mais indéniablement, chaque époque a eu son rockeur à deux roues : Merckx-Elvis dans les années 70, Bradley Wiggins-Gallagher dans les années 2010, et surtout, Marco Pantani-Bono dans les années 90. Petit portrait en mode Selle, Drugs and Rock’n’roll.
“Son regard est magnétique, dur, impénétrable, presque sévère, il porte un bouc à la Trotski, un bandana et des lunettes fumées dont le design rappelle le modèle en cuir des aviateurs qu’utilisait le champion des années 30, la “locomotive humaine”, Learco Guerra, pour se protéger de la poussière et des projections de silex. Son coeur, ses muscles, la forge de ses poumons, tout fusionnait dans une parfaite harmonie et les écarts qu’il prononçait derrière lui se chiffraient en minutes.
Près de neuf minutes pour Ullrich. Un retard éloquent.
“Cette victoire servira aux générations futures à comprendre qui j’étais”, commentera Pantani sans fausse modestie mais conscient d’avoir oeuvré ce jour-là pour la postérité.
En France, plus de cinq millions de téléspectateurs avaient suivi le passage au Galibier, ce qui en faisait l’égal en termes d’audience d’un Schumacher, d’un Ronaldo, d’un Holyfield. Le public redécouvrait un cyclisme d’humeur, anesthésié par le règne de Miguel Indurain. “Te voir dans le Galibier m’a fait rajeunir de quarante ans !” s’était enthousiasmé au téléphone le vieux Gino Bartali, diminué par la maladie. Pour Valerio Piccioni, journaliste-écrivain, le Romagnol avait “racheté l’amertume de la Coupe du monde de Football” où l’Italie de Maldini s’était fait éliminer sans éclat par la France de Zidane.
Sur les Champs-Elysées, Felice Gimondi, vainqueur du Tour en 1965, lui avait donné l’accolade sans que l’on sache lequel des deux était le plus fier, du Romagnol ou de son prédécesseur, ravi de se prolonger dans le succès de son cadet. Pantani restait fidèle à lui-même, froid et distant mais vrai dans la victoire comme avant lui Merckx, Anquetil, Hinault, Fignon, allergiques aux grandes effusions populaires, aux familiarités précaires. A Nino Minolitti de la Gazetta dello Sport qui s’étonnait de ne l’avoir pas vu pleurer de joie, il avait dit : “Je ne pleure jamais, sauf quand je me fous du shampoing dans les yeux”.
-------

En 1956, les étapes du Tour ne faisaient pas 200 bornes, mais 350. Les vélos ne pesaient pas 8 kg, mais 15. Et les routes de montagne n’étaient pas des billards aux revêtements parfaitement roulants, mais plutôt des chemins muletiers à peine goudronnés.
“La course sortait des Alpes par les gorges du Cians. Depuis une dizaine de kilomètres, on vivait dans une cicatrice de la terre. Pas une habitation ; pas un être humain ; pas un mètre de chemin sur lequel la cluse en refermât sa muraille rouge d’où l’eau ruisselait, arrachant aux parois des éclats de rochers qui s’en allaient teinter en contrebas les flots rosés du torrent. Cette plongée hallucinante avait achevé de disséminer les coureurs, idoles gluantes tombées de la montagne, une par une, comme les perles d’un collier rompu. Les voitures suiveuses elles-mêmes s'abandonnaient à un destin individuel. Chacun ne roulait plus que pour soi, soucieux de rapatrier sa carcasse dans la vallée… Soudain, dans le pan coupé d’un virage, on aperçut une silhouette fichée, avec un bicyclette soudée aux pieds. Personne devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche : seule, cette épave au regard vitreux, saisie dans un bloc de gel et d’absence, geignant. Il tremblait et des ondes rapides secouaient les muscles de ses cuisses tachées de sang. Il n’avait même plus ce réflexe de remonter en selle qu’ont les coureurs dans le coma athlétique, quand on leur présente un vélo. Le devoir ingrat consistait à lui dire : “Repars pendant que tu es un peu chaud encore… Roule doucement, il y en a d’autres derrière…” Et lui, il répondait : “J’ai froid.”
Il y avait là, dans cette voiture où nous étions, des bidons de thé, des aliments. Mais le règlement interdit aux suiveurs et aux parents de ravitailler les concurrents. Ceux-ci ne doivent tenir leur provende que du hasard des rencontres et, en quelques points privilégiés du parcours, de l’initiative des organisateurs. Du moins était-il permis de lui offrir un peu de chaleur, avec les moyens du bord. On l’amena contre le moteur de la voiture qu’on fit tourner plus fort. On souleva le capot et il resta là un moment, à demi allongé sur le radiateur, les yeux braqués sur ce coude précis de la descente où, l’instant d’avant, il dévalait à soixante-dix à l’heure, ses mains agiles caressant les poignées de freins avec aisance et certitude. Maintenant, ses mains, il les promenait dans sa chevelure dégoulinante où le sparadrap d’une blessure de la veille lui faisait une tonsure. Puis il tâtait en vain les poches de son maillot, vides comme son bidon et comme son regard vide. Cet homme n’avait plus rien au monde, que la peau et les os perçant à travers son cuissard déchiré. “Du courage ! … Monaco n’est pas loin (100km!). Tout à l’heure tu verras la mer, tu seras chez toi…”
-------

Mais c’est qui, ces gens qui poireautent des heures sur les routes du Tour pour entr’apercevoir des mecs en cuissard qui les dépassent en ½ seconde à peine ? Ces supporters qui sont dans tous les virages, ils sont là depuis les débuts du tour, et ils sont toujours aussi à fond... comme le montre cet extrait où Dino Buzzati décrit la dérive de Gino Bartali.
"Bartali a été semé. Dans la côte de Pratola, à 50 kilomètres de Salerne, Fausto Coppi pédale de toutes ses forces. Il est en tête d’un groupe d’une dizaine d’autres coureurs, mais parmi eux ne se trouve aucun membre de son équipe, il passe en solitaire : “Et Bartali ?” demandent les gens. Bartali n’est pas là. Bartali est-il dans le second groupe ?
Le soleil, des collines verdoyantes, un môme, des pins, des vignes, trois autres moines sous un peuplier. Une toute petite fille, qui bat des mains. De soudains nuages de poussière là où la route est en réparation. Des gamins de tout âge. Un homme estropié, dans sa petite voiture. Des nuées qui viennent de l’est. Et sous la petite casquette blanche son visage anguleux, cuit par le soleil et la fatigue. Il regarde vers l’arrière. Personne ne vient l’aider ? Non, personne… Il a déjà pris quatre-cent mètres d’avance ; il en a cinq cents, six cents, à présent.
Devant nous, qui le précédons, une étendue de mains qui s’agitent, faisant un geste interrogatif typique des gens du sud, doigts joints et tendus vers le haut. C’est un appel péremptoire, presque indigné. Ils sont là, à attendre depuis une heure, ils n’en peuvent plus, ils veulent savoir. Qui est en tête ? Qui gagne ? Que sommes-nous venus faire ici - ont-ils l’air de dire - si ce n’est leur apporter des nouvelles ? Qui est en tête ? Coppi. “Bravo !” hurlent les garçons en faisant des sauts de joie en l’air et en échangeant des coups de poing pour exprimer leur joie. En ce moment, ils nous embrasseraient, ils seraient disposés à faire n’mporte quoi pourvu que cela nous fasse plaisir. D’autres visages, cependant, s’assombrissent avec une promptitude quasiment ridicule. “Et Bartali ?” Bartali est derrière. “Bartali a été lâché ?” nous hurlent-ils en implorant un démenti de notre part. Il n’y a rien à démentir, c’est bel et bien cela. Mais nous n’avons pas le temps de discuter. Nous fonçons à travers les campagnes ; à une vitesse vertigineuse des visages sans cesse renouvelés défilent sur notre droite et notre gauche par milliers, interminables galerie humaine dans un état d’extrême excitation. Ces gens ont tout oublié : ce qu’ils sont, le travail qui les attend, les maladies, le luxe, les traites à payer, les maux de tête, l’amour, tout excepté ce fait mémorable : Fausto Coppi est en tête, Bartali a du retard et continue à perdre du terrain."
-------

Pour les fans de vélo, les champions cyclistes sont de véritables rock stars. Certains plus que d’autres, mais indéniablement, chaque époque a eu son rockeur à deux roues : Merckx-Elvis dans les années 70, Bradley Wiggins-Gallagher dans les années 2010, et surtout, Marco Pantani-Bono dans les années 90. Petit portrait en mode Selle, Drugs and Rock’n’roll.
“Son regard est magnétique, dur, impénétrable, presque sévère, il porte un bouc à la Trotski, un bandana et des lunettes fumées dont le design rappelle le modèle en cuir des aviateurs qu’utilisait le champion des années 30, la “locomotive humaine”, Learco Guerra, pour se protéger de la poussière et des projections de silex. Son coeur, ses muscles, la forge de ses poumons, tout fusionnait dans une parfaite harmonie et les écarts qu’il prononçait derrière lui se chiffraient en minutes.
Près de neuf minutes pour Ullrich. Un retard éloquent.
“Cette victoire servira aux générations futures à comprendre qui j’étais”, commentera Pantani sans fausse modestie mais conscient d’avoir oeuvré ce jour-là pour la postérité.
En France, plus de cinq millions de téléspectateurs avaient suivi le passage au Galibier, ce qui en faisait l’égal en termes d’audience d’un Schumacher, d’un Ronaldo, d’un Holyfield. Le public redécouvrait un cyclisme d’humeur, anesthésié par le règne de Miguel Indurain. “Te voir dans le Galibier m’a fait rajeunir de quarante ans !” s’était enthousiasmé au téléphone le vieux Gino Bartali, diminué par la maladie. Pour Valerio Piccioni, journaliste-écrivain, le Romagnol avait “racheté l’amertume de la Coupe du monde de Football” où l’Italie de Maldini s’était fait éliminer sans éclat par la France de Zidane.
Sur les Champs-Elysées, Felice Gimondi, vainqueur du Tour en 1965, lui avait donné l’accolade sans que l’on sache lequel des deux était le plus fier, du Romagnol ou de son prédécesseur, ravi de se prolonger dans le succès de son cadet. Pantani restait fidèle à lui-même, froid et distant mais vrai dans la victoire comme avant lui Merckx, Anquetil, Hinault, Fignon, allergiques aux grandes effusions populaires, aux familiarités précaires. A Nino Minolitti de la Gazetta dello Sport qui s’étonnait de ne l’avoir pas vu pleurer de joie, il avait dit : “Je ne pleure jamais, sauf quand je me fous du shampoing dans les yeux”.
-------
Allez, pour se faire plaisir, un rab' de Blondin :
Allez, pour se faire plaisir, un rab' de Blondin :
Une étape du Tour, c’est un long moment d’attente - ou d’ennui, c'est selon. Ce qui est génial, c’est que tout peut se passer à n’importe quel moment. Comme dans cette étape où, à quelques jours de l’arrivée, Fédérico Bahamontès - qu’on appelait aussi L’Aigle de Tolède - s’envole enfin au dessus de la mêlée.
"Il ne restait plus à gravir que le petit col de Luitel, comme nous l’appelions, sans l’avoir jamais vu. Il se présentait au loin comme un colline assez touffue, sans ces pans coupés à la hache de Dieu ni ces éboulis qui donnent à penser que la montagne vient à vous, si l’on ne va à elle. On eût dit d’un jardin suspendu assez haut il est vrai puisqu’il faut aller le chercher à 1200 mètres, mais plein de détours moelleux, de virages en forme d’allées, de bosquets ombragés pour une fin d’après-midi amicale dans la trève des querelles.
C’était méconnaître que nous pénétrions là un nouvel aspect de la montagne : un col assez protégé qu’on pouvait considérer comme un stade, autant dire un lieu où souffle l’esprit de la performance. Charly Gaul ne tarda pas à nous le faire savoir. En quelques minutes d’ascension d’une raideur savamment camouflée, le Luitel nous livra ce que ni l’Aubisque, ni Peyresourde, ni l’Izoard ni la Croix-de-Fer n’avaient pu nous donner : l’envol de l’ange retrouvé et la dislocation, irrémédiable cette fois, de notre escorte. Ici, Bahamontès lui-même jetait son vélo arachnéen d’un bord de la route à l’autre avec le geste pesant d’un déménageur qui se débarasse d’un piano, là Stan Ockers tendait une main hagarde vers un mère de famille occupée à faire tiédir un biberon, qu’il prenait pour un bidon offert. Cependant, Gaul montait toujours et sa démarche d’une apparente frivolité nous mettait en tête des vers de Virgile. Il était le fameux berger Tityre, après que celui-ci se fut décidé à quitter le farniente. Le réveil nous le rendait au maximum de sa férocité légère.
A la fin, ayant rassemblé dans son sillage l’unanimité des suiveurs pour une grandiose et admirative “conduite de Grenoble”, il plongea dans la vallée. Pour la première fois, un champion gagnait détaché une étape de ce Tour de France-là et mettait son inspiration en harmonie avec le terrain qu’on lui avait choisi."
"Il ne restait plus à gravir que le petit col de Luitel, comme nous l’appelions, sans l’avoir jamais vu. Il se présentait au loin comme un colline assez touffue, sans ces pans coupés à la hache de Dieu ni ces éboulis qui donnent à penser que la montagne vient à vous, si l’on ne va à elle. On eût dit d’un jardin suspendu assez haut il est vrai puisqu’il faut aller le chercher à 1200 mètres, mais plein de détours moelleux, de virages en forme d’allées, de bosquets ombragés pour une fin d’après-midi amicale dans la trève des querelles.
C’était méconnaître que nous pénétrions là un nouvel aspect de la montagne : un col assez protégé qu’on pouvait considérer comme un stade, autant dire un lieu où souffle l’esprit de la performance. Charly Gaul ne tarda pas à nous le faire savoir. En quelques minutes d’ascension d’une raideur savamment camouflée, le Luitel nous livra ce que ni l’Aubisque, ni Peyresourde, ni l’Izoard ni la Croix-de-Fer n’avaient pu nous donner : l’envol de l’ange retrouvé et la dislocation, irrémédiable cette fois, de notre escorte. Ici, Bahamontès lui-même jetait son vélo arachnéen d’un bord de la route à l’autre avec le geste pesant d’un déménageur qui se débarasse d’un piano, là Stan Ockers tendait une main hagarde vers un mère de famille occupée à faire tiédir un biberon, qu’il prenait pour un bidon offert. Cependant, Gaul montait toujours et sa démarche d’une apparente frivolité nous mettait en tête des vers de Virgile. Il était le fameux berger Tityre, après que celui-ci se fut décidé à quitter le farniente. Le réveil nous le rendait au maximum de sa férocité légère.
A la fin, ayant rassemblé dans son sillage l’unanimité des suiveurs pour une grandiose et admirative “conduite de Grenoble”, il plongea dans la vallée. Pour la première fois, un champion gagnait détaché une étape de ce Tour de France-là et mettait son inspiration en harmonie avec le terrain qu’on lui avait choisi."
-------
Le Tour commence samedi. Pour en savoir plus, c'est ici.